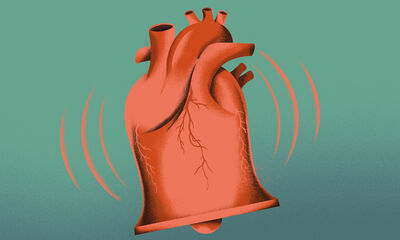par Fabienne Maleysson
MédecineLes femmes dans l’angle mort

La santé des femmes a, jusqu’à une date récente, été laissée dans l’ombre par les chercheurs et les médecins. Pourtant, la prévalence des maladies, les symptômes, l’efficacité et l’innocuité des traitements peuvent différer sensiblement selon le sexe.
« Je suis désolée, mais vous n’aurez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Je n’ai pas de notion de symptôme, traitement ou autre qui diffère en fonction du genre. » La réponse de cette jeune fille après six ans d’études de médecine en dit long sur l’indifférence qui entoure la distinction entre hommes et femmes en matière de santé. Nous qui l’avions sollicitée pour savoir si l’enseignement avait évolué ces derniers temps en avons été pour nos frais. Que les futurs soignants ne soient pas sensibilisés à cette question a de quoi surprendre. Car les organismes des personnes des deux sexes sont à l’évidence dissemblables, et ce constat est loin de se réduire à des aspects visibles à l’œil nu, comme les tailles et poids moyens, les organes reproducteurs ou la pilosité. Portant des paires de chromosome XX pour la population féminine, XY pour la masculine, chacune de nos cellules en atteste : nous ne sommes pas tous faits sur le même modèle ! Autre divergence fondamentale, le système hormonal. Chez les unes, ce sont les œstrogènes et la progestérone qui priment ; chez les autres, les androgènes, parmi lesquels la testostérone. Sur ce plan, la vie des femmes prend des contours changeants, avec les variations liées au cycle menstruel, les éventuelles grossesses et la contraception, puis, plus tard, la ménopause.
Quand la recherche néglige le sexe faible
En dépit de cette réalité, la santé de tous et toutes a, pendant des lustres, été pour l’essentiel envisagée comme si ces différences n’existaient pas. C’était notamment le cas dans le monde de la recherche, grâce auquel les connaissances sur les maladies et les traitements progressent constamment. Le statut du « sexe faible » a longtemps pu expliquer qu’on ne songe pas à s’en préoccuper. Par la suite, d’autres considérations ont conduit à exclure ces dames des protocoles. Délivré aux femmes enceintes au détour des années 1960, un antinauséeux, le thalidomide, a provoqué des malformations chez leurs bébés. Quant au Distilbène, utilisé pendant une trentaine d’années, il n’en finit pas de faire des dégâts sur la descendance de celles à qui on en a prescrit pendant leur grossesse. De quoi alerter les expérimentateurs sur les potentialités nocives pour l’embryon des médicaments qu’ils testaient. Et, comme toutes les femmes en âge de procréer risquaient, à leurs yeux, de se retrouver enceintes (1), ils les ont « blacklistées » dans la plupart des essais. La conséquence est double : non seulement ce choix a privé de précieuses informations sur la santé féminine en général, mais il a fait de la grossesse une terra incognita pour la quasi-totalité des médicaments. Selon un bilan portant sur 172 traitements approuvés entre 2000 et 2010, le risque de malformation du fœtus est indéterminé pour… 168 d’entre eux. Même « punition » concernant les femmes ménopausées, car la mise à l’écart a été, en pratique, étendue à tous les âges. On s’est donc privé de connaissances sur une période de la vie et un statut hormonal qui concernent pas moins de 40 % des Françaises.
Prendre en compte les particularités
Plus surprenant, avant même le stade clinique, lors de l’expérimentation animale, les femelles, elles aussi, ont été bien souvent mises sur la touche. Si le risque de fécondation peut aisément être maîtrisé, ce sont les fluctuations hormonales au cours du cycle qui ont longtemps justifié cette option. « L’habitude a été prise de ne pas utiliser de femelles pour cette raison. On craint que le stade où elles en sont dans leur cycle influence les résultats et que ça les fausse. Mais c’est un raisonnement complètement empirique, et qui ne repose pas sur des constats bien étayés, relève Sophie Gautier, chercheuse en pharmacologie dans une unité spécialisée en neurosciences de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). D’ailleurs, selon une synthèse de près de 300 publications en neurosciences, il n’y a pas plus de variabilité, quels que soient les paramètres étudiés, au sein du groupe des femelles que dans celui des mâles. » Pas de raison, donc, d’exclure celles-ci par principe… Et, dans les cas où des arguments laissent supposer que le cycle des femmes interfère avec l’efficacité ou la tolérance des médicaments qu’on leur délivre, fermer la porte des labos aux femelles revient à se voiler la face. « Certes, cela complexifie le travail de regarder selon la phase du cycle : il faut plus de sujets, plus de prélèvements, plus d’analyses. Toutefois, si l’on a de bonnes raisons de penser que cela a une influence, on doit le prouver scientifiquement », estime Angèle Gayet-Ageron, professeure associée à la faculté de médecine de Genève, qui appuie les chercheurs dans la conception de leurs études.
Comme de plus en plus de scientifiques, l’experte plaide pour que l’on cesse de faire l’impasse sur les particularités de chaque sexe. Car, « dans la vraie vie », une évidence se dessine de plus en plus clairement : hommes et femmes ne sont pas égaux face à la maladie. Sur le risque de survenue de certaines pathologies, la balance penche, selon les cas, d’un côté ou de l’autre. Au-delà des affections gynécologiques qui leur sont évidemment propres, les femmes sont, par exemple, plus souvent touchées par la plupart des maladies auto-immunes (lire l’encadré « Immunité »), les troubles thyroïdiens (six fois plus que les hommes), les migraines (deux à trois fois plus, et certaines d’entre elles constituent un facteur de risque cardiovasculaire), les infections urinaires (20 à 40 fois plus !), etc. En revanche, elles souffrent moins de la très grande majorité des cancers – et en meurent moins lorsqu’elles en sont atteintes. Mais l’évolution de la maladie et la réaction aux traitements n’épousent pas forcément les mêmes contours que chez leurs compagnons. À ce propos, une équipe de chercheurs américains déploraient récemment que, « malgré leur importance connue en médecine clinique, les différences basées sur le sexe et le genre [fassent] partie des facteurs les moins étudiés affectant la susceptibilité au cancer, sa progression, la survie et la réponse thérapeutique ».
Un cri d’alarme a été lancé
Si ces derniers évoquent la réaction aux traitements anticancéreux, c’est qu’il est désormais établi qu’il existe, là aussi, des inégalités. « Plusieurs études suggèrent une meilleure réponse des hommes à l’immunothérapie », précise Jean-Charles Guéry, immunologiste à l’Inserm. Et, quelle que soit l’option thérapeutique (chimiothérapie ou autre), le risque d’effets secondaires est accru d’un tiers chez les femmes. La cancérologie n’est pas une exception ; d’une manière générale, les organismes des unes et des autres ne « gèrent » pas forcément les médicaments de la même façon. Poids moyen, répartition entre muscles et graisses, temps de transit et autres paramètres physiologiques liés au sexe pourraient exercer une influence sur l’efficacité de certains médicaments et leurs effets secondaires. Cependant, comme la pharmacologie reste l’un des domaines de la recherche où la place des femmes et des femelles est réduite à la portion congrue, les connaissances demeurent malheureusement parcellaires. « On en est toujours à raisonner à partir d’une personne virtuelle qui est un homme de 70 kg pour définir la posologie de chaque spécialité, déplore Sophie Gautier. C’est peu pertinent, en particulier pour les médicaments à “marge thérapeutique étroite”, dont la dose efficace est proche de la dose toxique. » En ce qui concerne les vaccins, la réponse des femmes est, pour nombre d’entre eux, meilleure. Cependant, elles développent aussi davantage d’effets secondaires. Pour autant, la perspective de délivrer des doses adaptées n’est pas (encore) envisagée.
Notons toutefois que les pratiques en vigueur dans les laboratoires ont récemment évolué, sous l’influence des changements sociétaux et surtout parce que, au sein même du monde de la recherche, des voix se sont élevées pour réclamer qu’elles correspondent davantage à la réalité. « Un véritable cri d’alarme a été lancé pour dire : arrêtons d’extrapoler abusivement les données. Il ne faut plus partir du postulat que ce qui a été observé chez les hommes est forcément juste chez les femmes, mais le prouver ou l’infirmer », retrace Angèle Gayet-Ageron.
Depuis quelques années, les deux sexes sont plus équitablement représentés. Cependant, la bataille n’est pas gagnée, loin de là. Selon une analyse de plus de 700 publications dans des domaines variés – pharmacologie, immunologie, endocrinologie, neurosciences… –, l’inclusion des femelles ou des femmes, qui concernait un gros quart des recherches en 2009, se vérifiait sur la moitié d’entre elles en 2019. Une belle progression, mais qui laisse encore beaucoup de marge. D’autant que moins de 50 % de ces « bons élèves » analysaient leurs résultats selon le sexe. L’intérêt majeur de la démarche était par conséquent annihilé. Angèle Gayet-Ageron, qui conseille des équipes dans l’élaboration des protocoles, le confirme : « Nous faisons très régulièrement des remarques sur l’absence de planification d’analyses selon ce critère. Or, il est très important de les mener, car si les hommes répondent extrêmement bien à un traitement alors que chez les femmes, il n’est pas très efficace, le résultat moyen sera tout de même positif. » Hélas, cette pratique est loin d’être entrée dans les mœurs. Selon un recensement mené en 2021 et portant sur plus de 4 000 publications au sujet du Covid-19, moins de 10 % d’entre elles s’attachaient à différencier les constats par sexe. Encore s’agissait-il essentiellement d’études d’observation. Les essais de médicaments, eux, ne mentionnaient cette variable comme objet d’attention que dans… 1,3 % des cas !
Sensibiliser les futurs praticiens
Les choses ne bougent donc que lentement, mais en voyant le verre à moitié plein, on se dira qu’elles avancent tout de même. Plusieurs rapports émanant d’instances officielles, au premier rang desquelles la Haute autorité de santé, ont récemment insisté sur la nécessité de s’emparer du sujet. Sur le terrain, les esprits commencent à s’ouvrir. « Lorsqu’il y a 15 ans, aux Journées européennes de cardiologie, je proposais une session consacrée à la santé cardiovasculaire au féminin, on me regardait avec des yeux ronds en réduisant cela à du militantisme féministe, se souvient Claire Mounier- Véhier, professeure de médecine vasculaire au CHU de Lille. C’est moins le cas à présent. »
Pour celle qui parcourt la France avec son association Agir pour le cœur des femmes et ses autobus proposant des dépistages gratuits, le diable se cache parfois dans les détails : « Les mannequins sur lesquels s’entraînent les étudiants en médecine à qui j’enseigne sont tous… masculins. Je leur fais remarquer que non seulement les femmes ont de plus en plus d’infarctus, mais qu’il faut savoir et oser les masser, même si elles ont des seins ! » Et c’est autant de futurs médecins sensibilisés à la question. De même pour leurs congénères suisses, élèves d’un professeur sexagénaire, qui confie : « Avant, j’utilisais des dessins d’hommes qui se tiennent la poitrine pour représenter la douleur thoracique. Actuellement, je m’en sers pour montrer le risque de biais de genre » (lire l’encadré « Maladies cardiovasculaires »). Reste à généraliser cette sensibilisation. À l’heure où la médecine personnalisée est présentée comme une voie d’avenir, il serait inconcevable de laisser dans l’ombre une caractéristique aussi distinctive que le sexe des patients.
(1) Alors que, dans certaines situations, ce risque est très faible, voire nul : contraception rigoureusement suivie, stérilité, absence de rapports hétérosexuels.
Différences hommes-femmes - Au-delà du sexe biologique
Si la biologie a son importance, les particularités liées au sexe et susceptibles d’influer sur la santé ne s’y réduisent pas. Ainsi, la population féminine est plus touchée par la précarité : elle représente 70 % des travailleurs pauvres et 85 % des familles monoparentales. Des situations qui compromettent le respect des recommandations en matière de prévention – nutrition, activité physique – et sont souvent imbriquées avec des déterminants psychiques. Les conséquences sont potentiellement graves. Ainsi, une vaste étude européenne a démontré que les « facteurs psychosociaux » réunissant la dépression, le stress, les événements marquants de la vie et l’impression de ne pas maîtriser le cours de son existence pesaient davantage que le tabac ou l’obésité dans le risque de survenue d’un infarctus, et ce uniquement chez les femmes. Lesquelles ont aussi un rapport à la santé différent de leurs compagnons. En cas de symptômes laissant supposer une crise cardiaque, elles ont tendance à attendre plus longtemps (37 minutes de plus, selon une étude suisse) avant d’appeler les secours, dans un contexte où chaque minute compte. Des facteurs sociétaux entrent également en jeu. Par exemple, le diktat de la minceur touche bien davantage les femmes. Pour s’y conformer, certaines entreprennent des régimes successifs dont les effets nocifs ont été maintes fois pointés par les autorités sanitaires. D’autres recourent à des pilules miracles, potentiellement toxiques : le Mediator était souvent prescrit dans un objectif d’amaigrissement, et très majoritairement à des femmes.
Maladies cardiovasculaires - Une menace sous-estimée

On pense encore que les affections cardiovasculaires, et notamment l’infarctus, touchent avant tout les hommes. À tort. Les femmes sont elles aussi concernées.
Plus 5 % par an : la progression des hospitalisations pour infarctus du myocarde chez les femmes autour de la cinquantaine est assez spectaculaire pour être qualifiée de « préoccupante » par Santé publique France. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, et dans celui de certains professionnels de santé qui en sont restés aux notions acquises dans leur jeunesse, l’infarctus demeure une maladie typiquement masculine. Un schéma qu’il est d’autant plus important de nuancer que les symptômes féminins peuvent s’avérer atypiques : au lieu de l’emblématique douleur dans la poitrine irradiant vers le bras gauche et la mâchoire, il arrive que des signes digestifs, un mal de dos aigu ou une sensation d’oppression prédominent.
Des médecins qui passent à côté
Les femmes, et même les médecins, ne le savent pas toujours. On ignore aussi généralement que si ces dernières succombent moins souvent à un infarctus que les hommes, elles meurent davantage d’autres causes liées à l’appareil circulatoire, comme l’insuffisance cardiaque, l’arythmie ou l’accident vasculaire cérébral.
Par ailleurs, certaines pathologies de la sphère cardiovasculaire leur sont spécifiques. Elles représentent ainsi 9 cas sur 10 de dissection spontanée de l’artère coronaire, une forme d’infarctus dont la recherche s’est désintéressée jusqu’à une date récente. Même proportion avec le « syndrome du cœur brisé », conséquence potentiellement grave d’un stress intense. Quant à l’artérite (obstruction des artères des jambes), elle met parfois du temps à être repérée : « Les médecins passent souvent à côté chez les patientes, car ils pensent que c’est un problème typiquement masculin, remarque Claire Mounier-Véhier, professeure de médecine vasculaire au CHU de Lille et cofondatrice de Agir pour le cœur des femmes. Il n’est pas rare d’en voir qui sont traitées depuis des mois pour une sciatique diagnostiquée à tort. »
Les facteurs de risque s’accumulent
Que les femmes soient fréquemment touchées par les maladies cardiovasculaires n’a rien d’étonnant, car elles cumulent les facteurs de risque. À consommation égale de tabac, elles sont plus exposées à ces pathologies, avec une différence de 25 % en leur défaveur. Surtout, leur « vie hormonale » joue à plein. La grossesse induit parfois des soucis qu’on croit temporaires (prééclampsie, hypertension gravidique, diabète gestationnel), mais qui font le lit de ces troubles. La contraception œstroprogestative n’a rien d’anodin, elle est même contre-indiquée après 35 ans en cas de surpoids, tabagisme ou diabète, et les médecins n’en tiennent pas toujours compte. « Les cancers du sein ne sont malheureusement pas rares et certains traitements affectent le muscle et les valves cardiaques, ajoute Claire Mounier-Véhier. Enfin, après la ménopause, le risque devient similaire à celui des hommes à cause de la chute des œstrogènes protecteurs. La prise de poids, l’hypertension artérielle, l’épaississement des artères, mais également les troubles du sommeil qui peuvent survenir à cette période vont favoriser les maladies cardiovasculaires. » Une alimentation variée, essentiellement végétale, et surtout une activité physique régulière aident à les prévenir. Quant au stress, qui pèse aussi de tout son poids, il est possible d’apprendre à le gérer par des pratiques spécifiques (relaxation, yoga, méditation), faute de pouvoir toujours s’en prémunir.
Immunité - Efficace… parfois trop !
Les trois quarts des personnes souffrant de sclérose en plaques sont des femmes. La proportion monte à 85 % pour le lupus érythémateux. Et la polyarthrite rhumatoïde les touche trois fois plus que les hommes. Bref, les maladies auto-immunes en général les ciblent plus volontiers. C’est le revers de la médaille, car elles ont un système immunitaire globalement plus performant : elles résistent mieux aux infections et leur réponse aux vaccins est plus efficace. On l’a vu notamment avec le Covid-19, leur taux d’anticorps décroît moins vite que chez l’homme, que ce soit après une infection ou une injection. Malheureusement, cette efficacité demeure quand il s’agit de se retourner contre son propre organisme, comme dans les maladies auto-immunes. Ou de surréagir à l’encontre de substances normalement inoffensives, mécanisme à l’œuvre en cas d’allergie : l’asthme est ainsi deux fois plus fréquent, mais aussi plus sévère chez les femmes. L’explication tient à la fois à des causes génétiques et hormonales. Leur chromosome X, présent en double exemplaire, est particulièrement riche en gènes liés aux fonctions immunitaires, et des « bugs » font parfois que certains ne sont pas inactivés lorsqu’il le faudrait. Quant aux œstrogènes, ils boostent l’immunité, alors que les androgènes ont tendance à l’inhiber. « Quand, il y a 20 ans, on s’est mis à travailler avec mon équipe sur les raisons des dissemblances entre les sexes dans la réponse immunitaire, nos collègues nous ont regardés avec perplexité, comme si nous accordions trop d’importance à un épiphénomène, se souvient Jean-Charles Guéry, immunologiste à l’Inserm, chef du groupe Différences liées au sexe dans l’immunité. Aujourd’hui, on en parle dans tous les colloques. » Un premier pas, peut-on espérer, vers une adaptation des traitements.
Endométriose - La fin de l’indifférence
Si les patientes n’avaient pas pris le taureau par les cornes, l’endométriose serait restée dans l’ombre. Pourtant, il ne s’agit en rien d’une maladie rare : on estime que 1 femme sur 10 en est atteinte. À la clé, toute une panoplie de douleurs, parfois insoutenables, notamment – mais pas seulement – dans la région pelvienne, pendant les règles et au cours des rapports sexuels. C’est aussi la première cause d’infertilité en France : la moitié des cas de stérilité féminine y serait liée. Sur le silence qui a longtemps entouré la maladie, de nombreuses explications ont été avancées. Tabou des règles, idée ancrée selon laquelle il est normal de souffrir pendant cette période, lésions parfois invisibles à l’imagerie, absence de relation entre leur taille et l’intensité de la douleur incitant à ne pas prendre les plaintes au sérieux…
Le mécanisme aussi restait obscur, il commence tout juste à être mieux cerné. Chercheuse à l’Institut Cochin, Ludivine Doridot a voulu contribuer à améliorer les connaissances, « même si, au sortir de ma thèse, en 2013, on m’a dissuadé de m’intéresser à la santé des femmes, au motif que ce n’était pas financé et que ma carrière risquait d’en pâtir ». En analysant le sang menstruel des patientes atteintes, elle tente de comprendre certains ressorts de la pathologie. Une vingtaine d’autres équipes travaillent sur des axes différents, visant la mise au point de diagnostics précoces et de traitements efficaces. « En attendant, en cas de souffrance anormale, il ne faut pas hésiter à consulter, au besoin un professionnel spécifiquement formé », conseille la scientifique. Leurs adresses se trouvent aisément sur Internet, même si certaines régions sont sous-dotées.
Diabète - Connaître les périodes à risque

Moins touchées que les hommes par le diabète, les femmes sont cependant exposées à des facteurs de risque spécifiques dont elles n’ont pas toujours conscience. Affectant 10 % d’entre elles, le syndrome des ovaires polykystiques, maladie hormonale la plus répandue chez celles en âge de procréer, doublerait le risque. Plus fréquent encore, le diabète gestationnel, qui concerne une grossesse sur six, multiplie par 7 à 10 l’éventualité de développer un « vrai » diabète à terme. « On conseille un dépistage lors de la consultation postnatale et tous les deux ans par la suite, précise Emmanuelle Lecornet-Sokol, endocrinologue. Mais s’occuper d’enfants en bas âge est prenant, et ces recommandations ne sont pas toujours respectées. Quant aux femmes vivant avec un diabète, il est très important qu’elles programment leur grossesse pour être suivies dès le début, car cette maladie induit des risques de malformations et c’est dans les premières semaines qu’il faut agir. Or, les diabétologues ne pensent pas toujours à aborder ce sujet, surtout quand leurs patientes ont dépassé 40 ans. » Plus tard, la ménopause constitue une autre période de bouleversement. « Prise de poids, fonte musculaire et manque d’œstrogènes favorisent le diabète. Et les femmes ne sont alors plus protégées des complications rénales ou cardiovasculaires de celui-ci, prévient la spécialiste. Consulter à ce moment-là et mettre en place de nouvelles habitudes de vie, comme une remise en mouvement progressive – l’activité physique étant fondamentale –, peut aider à éloigner cette perspective. »
Fabienne Maleysson
Lire aussi