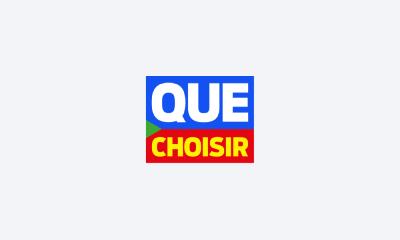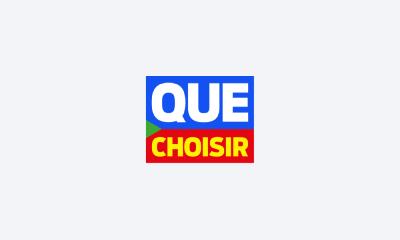par Fabienne Maleysson, Gaëlle Landry, Olivier Andrault
Ingrédients indésirables dans les cosmétiquesVos questions, nos réponses
Lors d’un tchat avec nos experts, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les ingrédients indésirables dans les produits cosmétiques. Vos interrogations et vos craintes concernaient aussi bien les substances, les produits et les marques, la réglementation… Retrouvez ci-dessous toutes nos réponses.
Les ingrédients indésirables en question
Pouvez-vous hiérarchiser les risques entre les perturbateurs endocriniens et des ingrédients a priori moins nocifs comme les irritants ou allergènes ?
Par ordre décroissant de « méchanceté » : perturbateurs endocriniens, allergènes, irritants. Mais c’est vraiment délicat, car les effets ne sont pas les mêmes. Entre l’effet d’un perturbateur endocrinien susceptible de se manifester dans des dizaines d’années et un puissant allergène comme la MIT (méthylisothiazolinone) qui déclenche une réaction violente et immédiate, on ne devrait pas avoir à choisir.
Faut-il arrêter d’utiliser tous ces produits contenant des substances indésirables même si aucun problème n’est survenu ?
Nous tentons de l’expliquer dans notre dossier. Nous conseillons d’éviter les perturbateurs endocriniens en particulier chez les enfants, les adolescents et les femmes enceintes car, en pratique, pour de nombreuses molécules, l’effet délétère est invisible.
Regardez bien nos fiches ingrédients : elles illustrent le niveau de risque avec une pastille de couleur. En gros, tout ce qui est rouge foncé est à bannir.
Nous vous conseillons aussi de lire notre article qui tente de répondre à la question « Que faire des produits cosmétiques qui contiennent des molécules toxiques ? »
Existe-t-il des alternatives aux substances indésirables ? Ou, au contraire, faudrait-il se passer de certains produits si on supprimait telle ou telle molécule ?
Oui, bien entendu, il existe des produits cosmétiques qui ne renferment pas de substances indésirables. Il faut se servir des outils que nous mettons à votre disposition pour les trouver, même si c’est laborieux.
Ma crème hydratante contient de la MIT, mais je n’ai pas de réaction cutanée. Est-ce que ce sont les allergènes tels que la MIT qui nous rendent allergiques ?
Ce n’est pas parce que vous n’avez pas de réaction que vous n’en aurez jamais. La MIT (méthylisothiazolinone) ne devrait plus être présente dans votre crème désormais, puisqu’elle vient d’être interdite dans les produits non rincés.
Est-il vrai que certains perturbateurs endocriniens ont été remplacés par d’autres substances nocives ? Si oui, sous quelle appellation ?
Les parabènes ont souvent été remplacés par la MIT (méthylisothiazolinone), allergène fréquent qui fait partie de notre liste d’ingrédients indésirables et qui est désormais interdit dans les produits non rincés.
Quels sont concrètement les effets des perturbateurs endocriniens ?
La science ne les cerne pas encore précisément. Il y a de nombreuses suspicions : effets sur la fertilité, sur le développement de cancers, notamment hormonodépendants (testicule, sein…), sur le cerveau, sur les phénomènes d’obésité et de diabète… Ce sont pour l’instant des pistes qu’il reste à explorer plus à fond. Comme les pathologies évoquées sont multifactorielles, la responsabilité des perturbateurs endocriniens est compliquée à déterminer. En tout cas, ils sont a priori plus risqués lors de certaines fenêtres d’exposition : grossesse, petite enfance, adolescence.
Pourquoi les fabricants utilisent-ils des produits nocifs et non naturels ? Est-ce (encore) une question d’argent, ou plutôt d’efficacité ?
Il n’y a évidemment aucune intention d’exposer délibérément les consommateurs à des risques potentiels. En revanche, il est évident que nombre de professionnels continuent à utiliser ces molécules problématiques tant qu’elles restent autorisées pour éviter d’avoir à reformuler leurs produits ou à modifier leurs emballages, ces reformulations étant évidemment assez compliquées pour eux.
Mais nous déplorons également que les fabricants ajoutent des composés problématiques dans le seul but d’apporter à leur produit des fonctionnalités sans intérêt réel pour les consommateurs. Ainsi, il n’y a aucune utilité à mettre des filtres UV dont certains sont des perturbateurs endocriniens dans des sticks à lèvres ou des colorations capillaires !
Le nom des produits indésirables est trop compliqué pour pouvoir les retenir, auriez-vous un moyen mnémotechnique pour les identifier plus rapidement ? En effet, même si j’ai imprimé leur liste, je ne suis pas sûr de l’avoir toujours sur moi !
Malheureusement, c’est compliqué, raison pour laquelle nous proposons une carte repère. Concernant les parabenes, tout de même, il existe un moyen mnémotechnique simple : ce sont le propyl- et le butylparaben qui ne sont « pas bons » (les mots commencent par P et B).
Pourquoi les PEG ne figurent-t-ils pas dans la liste des substances à éviter de « Que Choisir » ?
Nous avons choisi de ne recenser que les substances qui présentent un risque pour la santé humaine. Celles susceptibles de générer une pollution ne sont pas incluses.
Mais sachez que les référentiels bio excluent les PEG, comme de nombreux autres ingrédients largement employés dans les cosmétiques conventionnels, parce qu’ils ne sont quasiment pas biodégradables et que les stations d’épuration ne parviennent pas forcément à les retenir.
Le propylène glycol, que l’on retrouve presque toujours dans la composition des cosmétiques, est-il réellement sans effet toxique pour la santé ?
Le propylène glycol est souvent qualifié, à tort, d’éther de glycol, famille chimique bien connue pour la nocivité de certains de ses membres. Pourtant le propylène glycol n’est qu’un simple diol, autrement dit un di-alcool qui remplit la fonction d’humectant dans les formules des produits cosmétiques. L’autre humectant bien connu est la glycérine. L’innocuité de ces deux composés très largement employés dans les produits hydratants n’est pas mise en doute.
Devons-nous nous inquiéter de la substance « petrolatum », notamment dans les cosmétiques pour enfants ?
Même problématique que pour les PEG : c’est son impact sur l’environnement qui pose un souci, il ne menace pas directement la santé humaine.
On parle – enfin – des ingrédients indésirables présents à foison dans les produits qu’on se tartine sur la figure et le corps chaque jour de l’année, mais guère des pots et tubes dans lesquels ils sont conditionnés. Or, les matières plastiques dans lesquelles les produits sont contenus larguent d’autres substances toxiques que l’on retrouve dans les crèmes. Pourquoi n’en parlez-vous pas ?
Nous avons déjà beaucoup à faire avec la chasse aux molécules problématiques issues des formules elles-mêmes. Ce tri est possible par une simple lecture des listes d’ingrédients, ce qui, même si cela s’avère laborieux pour le consommateur, reste aujourd’hui le seul moyen de choisir des produits cosmétiques sûrs. Ce que vous dénoncez, en revanche, relève de la problématique contenant-contenu qui exige de procéder à des mesures en laboratoire.
Je constate que de nombreux produits hydratants contiennent de l’alcool. Est-ce que c’est logique pour des soins hydratants ? L’alcool est-il une substance indésirable ?
L’alcool est un solvant couramment utilisé dans les produits cosmétiques. Il peut effectivement assécher la peau. On le rencontre notamment dans les sprays solaires où il sert de solvant pour solubiliser les différents constituants du mélange. À l’application, l’alcool s’évapore en partie, ce qui fait qu’une fraction seulement demeure sur la peau.
Dans les cosmétiques bio, il est souvent employé comme conservateur.
Nous ne le considérons pas comme un ingrédient problématique.
Le matin, quand ma femme se met de la laque sur les cheveux et que j’entre ensuite dans la salle de bains, cela m’irrite la gorge pour toute la journée. Je me demande si c’est dangereux pour moi et surtout pour nos enfants…
Les laques sont des aérosols qui diffusent dans l’air non seulement les substances contenues dans le produit (des allergènes, par exemple) mais aussi ce qui résulte des gaz propulseurs. Comme ils chargent l’air en composés organiques volatils (COV), ils devraient normalement être utilisés dans une zone bien ventilée, ce qui, dans la pratique, est un peu compliqué.
Un produit contenant des substances allergènes utilisé deux ou trois fois et n’ayant provoqué aucune allergie peut-il être considéré comme sans danger pour cette personne ?
Non, malheureusement : le seuil de sensibilisation est différent pour chacun et on peut devenir allergique à une substance qui ne nous a pas posé de problèmes même après plusieurs utilisations.
Le phénoxyéthanol est-il vraiment à proscrire dans tous les produits pour bébé (détergents, hygiène, etc.) ?
L’Agence nationale de sécurité du médicament juge que cet ingrédient ne doit être autorisé qu’en proportion minime (0,4 %) dans les produits destinés aux enfants de moins de 3 ans et proscrit dans les produits destinés au siège. Nous recommandons donc de l’éviter, en particulier dans les lingettes et autres crèmes pour les fesses irritées.
Nous n’avons que très rarement vu cet ingrédient dans les lessives testées. À notre sens, le premier ingrédient à éviter dans ce type de détergent si on a un bébé est la MIT (méthylisothiazolinone). Veillez aussi à rincer soigneusement (de nombreux lave-linge ont une option « rinçage plus »).
Quelle crème hydratante choisir pour le visage des bébés et des enfants ?
Nous ne pouvons pas vous conseiller un produit ou une marque, mais nous vous recommandons d’utiliser nos fiches ingrédients et notre carte-repère pour bien choisir. Dans tous les cas, évitez les ingrédients perturbateurs endocriniens et les allergènes. Cela dit, seuls les bébés et enfants ayant la peau particulièrement sèche ont besoin d’une crème hydratante.
J’ai une petite fille de 3 ans et après avoir lu votre dossier, je ne sais plus avec quel shampooing et quel savon la laver. Je suis complètement perdu !
Essayez d’éviter les tensioactifs potentiellement irritants comme le SLS. Il est très présent. Il existe des alternatives plus douces comme le lauryl sulfoacétate, le coco amphoacétate, le lauroyl glutamate ou encore le lauroyl sarcosinate.
Les vernis à ongles « 4 free » contiennent-ils du benzophénone ? Existe-t-il des vernis sans produits toxiques ?
Les vernis à ongles sont des concentrés de chimie. « 4 free » ou autre « X free », c’est un terme marketing, non encadré. Nous avons publié un test sur les vernis à ongles en juin 2016. Quelques références sont acceptables tout de même.
Je me pose des questions sur les vernis à ongles. Au départ, 3 ingrédients étaient décriés, puis c’est passé à 7, aujourd’hui quels sont les composants contenus dans les vernis à éviter ? Surtout pour une femme enceinte…
De nombreux composés susceptibles de figurer dans les vernis sont à éviter. Étant donné la fréquente présence de perturbateurs endocriniens, le mieux est de se passer de vernis à ongles pendant la grossesse.
Existe-t-il des teintures pour cheveux qui soient inoffensives ? Ayant fait une allergie sévère à un produit de coloration capillaire, je n’ai pas pu déterminer après consultation médicale quel était l’ingrédient en cause. Quelles substances faut-il éviter dans ce type de produits ?
En réalité, les teintures capillaires renferment très souvent des ingrédients indésirables, notamment des allergènes.
Nous avons choisi de n’intégrer que la p-phenylenediamine à notre liste de substances indésirables, car c’est la plus préoccupante ; mais attention, aucune coloration capillaire durable dite « permanente » n’est anodine.
Les substances sensibilisantes, irritantes, etc. sont quasi impossibles à recenser sous la forme d’une liste courte. Nous avons testé ces produits dans un comparatif en 2007 et sur les 17 références étudiées, toutes avaient récolté 2 carrés en composition (2 carrés = jugement mauvais).
C’est pourquoi nous conseillons d’aller plutôt vers des colorations végétales en acceptant l’idée que l’efficacité sera inférieure, c’est-à-dire que les cheveux blancs seront moins bien couverts.
Nous vous conseillons de lire notre test sur les colorations capillaires (accès réservé aux abonnés).
En quoi la résorcine que l’on trouve dans les shampooings colorants est-elle dangereuse ?
C’est une substance colorante assez agressive. Nous ne l’avons pas incluse dans notre liste car nous avons choisi d’insister sur la p-phenylenediamine, qui est la plus préoccupante.
Quels sont les effets indésirables du silicone dans les cosmétiques et les shampooings ?
Les silicones ont la réputation d’étouffer le cheveu car ils sont « filmogènes », c’est-à-dire qu’ils forment un film assez imperméable à la surface du corps qu’ils recouvrent. Dans les shampooings, les agents siliconés enrobent les cheveux et les rendent plus lisses, plus doux, et plus faciles à démêler.
Revers de la médaille, lorsqu’une fibre capillaire est endommagée, les dégâts seraient masqués et non réparés, soutiennent les détracteurs des silicones. Cela reste à démontrer.
Leur principal point noir est d’être des substances polluantes. Elles sont d’ailleurs exclues des cahiers des charges des cosmétiques bio.
Peut-on exiger de notre coiffeur qu’il nous montre les composants des produits dont ils se servent pour la couleur, les shampoings, les après-shampoings ?
Cela nous paraît légitime, vous pouvez le lui demander.
Sur quelles études vous basez-vous pour dire que les parabènes sont indésirables ? Ils sont réglementés et ont été récemment réapprouvés par la Commission européenne, notamment les ethyl- et methylparabens. Certains ont été interdits faute d’études. Les parabens ont fait l’objet d’un black-listage injustifié qui a conduit les industriels à les remplacer par des molécules allergisantes ou irritantes comme l’acide sorbique, l’acide benzoïque et surtout la methylisothiazolinone…
Vous nous avez mal lus. Nous avons écrit noir sur blanc : « Ceux à courte chaîne, ethylparaben et methylparaben (et les composés qui contiennent ce nom, comme sodium ethylparaben), ont été blanchis par les experts français et européens. À l’inverse, les plus dangereux (isobutyl-, isopropyl-, benzyl-, pentyl-, phenylparaben) sont interdits depuis 2014. »
Concernant le butylparaben et le propylparaben, qui figurent dans notre liste d’ingrédients indésirables, le comité d’experts européens (SCCS) a écrit dans son dernier avis, en 2013, qu’on ne dispose « d’aucune preuve adéquate sur leur sécurité d’usage dans les produits cosmétiques » et déplore le manque de données à ce sujet. Nous ne relayons donc pas des rumeurs infondées, mais des avis d’experts mandatés par la Commission européenne en vue d’assurer la protection des consommateurs.
Pourquoi ne pas avoir mentionné les doses identifiées par agent nocif par rapport aux taux en vigueur ? Par exemple, les concentrations utilisées d’ethylhexyl methoxycinnamate dans certains gels douches sont de 20 à 50 fois inférieures au niveau légal autorisé. Comment le consommateur peut-il identifier une concentration critique pour ce type de molécule ?
Les perturbateurs endocriniens et les allergènes, qui constituent la grande majorité de notre liste d’ingrédients indésirables, ont pour particularité de pouvoir être nocifs à très faible dose. Concernant les perturbateurs endocriniens, ils sont même parfois plus toxiques à faible dose qu’à dose plus élevée ! Donc, à nos yeux, leur présence suffit à être problématique.
Concernant en particulier l’ethylhexyl methoxycinnamate, qui est un filtre anti-UV, on voit mal pourquoi il serait indispensable dans des gels douches et shampooings.
Le service client de chez LIDL m’a affirmé ceci : « Notre fournisseur nous a confirmé que la quantité de cyclopentasiloxane dans le produit “Crème soin visage”, de la marque Cien, que vous trouvez actuellement dans nos magasins, est très faible. La concentration est non critique et très inférieure à une concentration à classer comme critique. »
Le cyclopentasiloxane n’est pas le perturbateur endocrinien sur lequel les soupçons sont les plus lourds, mais s’en passer serait préférable, quelle que soit sa concentration.
Étant donné que les trois quarts des produits cosmétiques contiennent des ingrédients indésirables, quels sont les moins risqués pour notre santé ? Est-il préférable que le produit contienne des allergènes ou bien des perturbateurs endocriniens ?
Notre liste ne contient que les références contenant un ou plusieurs ingrédient(s) indésirable(s) ou qui en contenaient l’an dernier. Il reste quand même pas mal de choix en rayon sans substances problématiques. Avec les allergènes, le risque est à court terme et les conséquences bien visibles ; avec les perturbateurs endocriniens, le risque est à long terme et on l’a moins précisément cerné.
Votre formulaire de signalisation ne s’adresse qu’aux perturbateurs endocriniens. Désirez-vous qu’on vous signale aussi les allergènes ? Comment ?
La seule présence des allergènes de la liste des 26 (provenant des parfums) n’est pas suffisante pour figurer dans la base de données. Pour le reste, les perturbateurs endocriniens ne sont pas seuls concernés par le formulaire, la MIT (méthylisothiazolinone), par exemple, n’en est pas un.
De quelle(s) manière(s) considérez-vous qu’un produit cosmétique est à bannir ? J’analyse les compositions depuis quelques années et je vois des composants indésirables chez de nombreuses marques, mais elles ne font pas partie de votre enquête, pourquoi ?
La liste des indésirables que nous avons établie correspond aux molécules les plus préoccupantes, selon nos propres recherches. Nous nous appuyons sur des avis d’experts en tenant compte des connaissances scientifiques et des preuves disponibles sur le risque associé à l’exposition à ces molécules. D’autres ingrédients font parfois parler d’eux, mais nos investigations n’ont pas permis de confirmer les soupçons les concernant.
Comment une substance peut-elle agir sur le système hormonal si elle figure dans un produit en utilisation uniquement externe ?
La peau n’est pas une barrière hermétique, plusieurs études ont montré que certains composants des cosmétiques passaient dans le sang.
Le sodium laureth sulfate est-il équivalent au SLS, d’un point de vue toxique ? Et le diméthicone est-il à considérer comme le cyclométhicone ?
Le laureth ne figure pas dans notre liste, car il est moins irritant que le sodium lauryl sulfate (SLS).
La dimethicone n’y est pas non plus, car elle n’est pas suspectée d’être un perturbateur endocrinien, contrairement à la cyclomethicone.
L’ammonium lauryl sulfate est-il aussi dangereux que le sodium lauryl (ou laurel) sulfate ?
Ils se classent tous les deux au même niveau, avec une irritation potentielle équivalente.
Utilisés dans les produits lavants (gels douches et shampooings), ils peuvent irriter la peau et le cuir chevelu, mais ce n’est pas systématique : certaines personnes y sont plus sensibles que d’autres.
Dans les dentifrices, ils peuvent être la raison d’aphtes à répétition ou se manifester par une légère desquamation au niveau des muqueuses. Qui n’a pas un jour eu cette désagréable sensation après s’être brossé les dents avec un dentifrice inadapté ? Là encore, ce n’est pas systématique, certaines personnes supportent très bien ces ingrédients.
Le risque lié à ces substances est explicité via des fiches ingrédients sur notre site Internet.
Si vous regardez les couleurs en détail, comme, dans les faits, SLS et ALS sont surtout présents dans les produits rincés, vous êtes face à un niveau de risque qualifié de « limité » (= pastille jaune) et seulement orange chez le tout-petit.
J’ai trouvé de l’ammonium laureth sulfate dans un shampoing bio acheté chez Biocoop il y a 2 ou 3 ans avec label « Cosmétique bio, charte Cosmebio » ! Qu’en pensez-vous ?
C’est normal, c’est autorisé par le cahier des charges Cosmebio. C’est le moins problématique de nos ingrédients indésirables
Vous lirez quelques précisions à ce sujet dans notre liste.
Dans vos tests, le dioxyde de titane, notamment sous forme de nanoparticules, n’est jamais recherché. Or il y en a partout (aliments, médicaments), y compris dans les cosmétiques, notamment les dentifrices. Le dioxyde de titane étant cancérigène, ne serait-il pas utile de recenser les produits qui en contiennent ?
Il faut distinguer deux choses : le dioxyde de titane (TiO2) en lui-même d’une part et sa forme nanoparticulaire d’autre part. Le TiO2 est classé cancérogène possible, mais cela ne suffit pas pour l’inclure dans notre liste des ingrédients indésirables car cette classification est très large, on y trouve même le café !
Concernant les nanoparticules, nous sommes en veille sur la question. Il est compliqué de se prononcer de façon catégorique car on ignore, quand on lit « titanium dioxyde » (E 171) sur une liste d’ingrédients, s’il est présent sous forme « nano » ou pas. Mais notre liste d’ingrédients indésirables évoluera avec l’état de la science et nos propres constats sur les produits.
Jusqu’à maintenant, aucun test validé et opposable aux fabricants n’était disponible, raison pour laquelle nous n’avons jamais inclus cette recherche dans nos tests.
Pourquoi y a-t-il du dioxyde de titane dans les dentifrices ? À quoi sert-il ? Est-il nécessaire au produit ?
Dans les dentifrices, c’est un colorant blanc ou un opacifiant. Il n’est pas nécessaire à l’action nettoyante ou à la conservation, seulement à améliorer l’aspect, à rendre la pâte blanche.
Est-ce qu’il y a des nanoparticules dans les cosmétiques ? Quels sont les termes qui les désignent ?
Jusqu’à présent, les ingrédients les plus couramment identifiés comme pouvant être nanoparticulaires dans les cosmétiques sont le dioxyde de titane (« titanium dioxyde » sur les étiquettes) et l’oxyde de zinc (« zinc oxyde »). Tous deux sont des filtres solaires et le dioxyde de titane est aussi un colorant/opacifiant. D’autres ingrédients peuvent se présenter sous forme « nano », mais il n’existe pas de liste exhaustive.
Théoriquement, les fabricants doivent l’indiquer en précisant [nano] après l’ingrédient concerné. Cependant, nous ne savons pas si cette réglementation est respectée au pied de la lettre par tous les fabricants car, pour l’instant, aucune méthode d’analyse validée ne permet le contrôle de son respect, par la Répression des fraudes ou par nous-mêmes, par exemple.
Atteint de spondylarthrite ankylosante sévère et de fibromyalgie, j’ai découvert qu’un des composants encapsulants de deux de mes médicaments est le dioxyde de titane. Quel est le risque, sachant que je devrais prendre de deux à quatre de ces pilules par jour (j’ai suspendu pour l’instant toute ingestion, même si cela rend plus sensibles certaines parties du corps) : cumulatif, cancérigène… ?
Nous ne pouvons que vous conseiller de continuer à prendre votre traitement s’il vous soulage ! Le risque lié aux nanoparticules est pour l’instant encore mal cerné, peut-être est-il important, peut-être est-il limité, donc ce n’est pas une bonne idée d’interrompre un traitement efficace pour éviter ce risque à long terme.
Peut-on utiliser le dioxyde de titane autrement qu’en nanoparticules ? Il est autorisé dans le cahier des charges Écocert… Il y en a dans une crème que j’utilise et la réponse du laboratoire est que cet ingrédient n’est pas utilisé sous forme « nano ». Comment faire la différence ?
Oui, le dioxyde de titane peut être présent à une taille non nanoparticulaire. Les cahiers des charges de produits bio excluent les nanoparticules (à l’exception des filtres solaires pour lesquels il est difficile de trouver des filtres non « nano »). Mais pour maîtriser le risque, le mieux à notre sens serait l’exclusion du dioxyde de titane en tant que colorant par ces cahiers des charges.
Une dermatologue m’a prescrit de la poudre minérale pour remplacer les produits solaires. Or j’ai découvert que tous ces produits supposés ne pas être nuisibles contiennent du dioxyde de titane. J’ai posé la question par Internet à un vendeur « bio » qui m’a répondu que le produit vendu en bio n’était pas le même ! Or une étude du CEA (Centre d’essai atomique) a déclaré que, bio ou pas, c’était le même dioxyde de titane…
À notre connaissance, le Commissariat à l’énergie atomique n’a pas fait une telle déclaration, mais le dioxyde de titane ne peut pas être bio puisque ce n’est pas une matière première cultivée. Le problème est que c’est un filtre solaire efficace (donc protecteur pour la peau) et non chimique, donc les fabricants, bio ou non, ont du mal à s’en passer.
Les marques et les produits cosmétiques
Pourquoi ne diffusez-vous pas une liste de produits ne contenant pas de produits toxiques (shampooing, lait pour le corps, démaquillants, produits pour bébé, etc.) ?
C’est impossible, il existe trop de références de produits cosmétiques sur le marché. On ne peut pas répertorier des dizaines de milliers de produits.
En outre, cela signifierait indirectement que nous conseillons ces produits sans les avoir testés, sans savoir s’ils sont efficaces. Or l’efficacité, c’est également important. Nous avons publié un article pour expliquer plus précisément pourquoi nous ne publions pas de liste positive.
Existe-t-il une liste exhaustive de l’ensemble des produits contenant des ingrédients indésirables ?
Non, cela n’existe pas. Nous-mêmes ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité, notamment pour des raisons de moyens en matière de temps (il existe plusieurs dizaines de milliers de références cosmétiques) et d’argent (nous achetons tous les produits et les faisons photographier).
Peut-on avoir la liste complète des marques utilisant des perturbateurs endocriniens en France ?
Non, cela n’existe pas, mais notre liste des produits recensés, notre carte repère à télécharger et nos fiches des molécules à éviter vous permettent de repérer les plus problématiques et d’éviter les produits en contenant.
Pouvez-vous hiérarchiser les perturbateurs endocriniens du plus nocif au moins nocif ?
La hiérarchisation des perturbateurs endocriniens (tout comme des autres molécules) est une des particularités de ce dossier. Regardez les infographies : vous avez trois codes couleurs. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas tous codés « rouge », certains sont même « jaune », ce qui veut dire « risque limité » et correspond aux molécules que l’on commence à surveiller parce que des études récentes les pointent du doigt. C’est le cas du BHT, qui n’est pas encore très documenté (pastille jaune = risque limité) ; à l’inverse, le BHA est classé « rouge » (= risque significatif) car il est très fortement suspecté d’effet perturbateur endocrinien.
Je vous ai transmis les marques LR et Sothys qui comportaient et comportent toujours des substances indésirables et je ne les vois pas dans votre liste. Je doute de votre indépendance. Avez-vous une explication ?
Nous avons eu plus d’un millier de signalements l’an dernier, nous en sommes à 800 cette année : il est possible qu’un produit nous ait échappé. Par ailleurs, certains signalements, après vérification, se sont révélés infondés, par exemple parce qu’il s’agissait de parabènes non présents dans notre liste d’ingrédients indésirables (methyl- ou ethylparaben) ou de phenoxyethanol dans des produits pour adultes. À noter que la seule présence d’allergènes de la liste des 26 ne suffit pas à inclure un produit dans notre liste, car ils sont omniprésents.
Vous pouvez désormais utiliser un formulaire vous permettant de signaler les produits cosmétiques qui contiennent des ingrédients indésirables et qui ne sont pas référencés dans notre liste.
Vous indiquez que le shampooing Bioderma Nodé A contient du propylparaben, et pourtant cette substance n’est pas indiquée sur le flacon…
Les fabricants reformulent leurs produits en permanence. Nous avons acheté ceux signalés en janvier (quelques-uns en décembre 2016) mais il se peut qu’une nouvelle formule cohabite dans les rayons avec l’ancienne, auquel cas nous en tiendrons compte dans notre prochaine mise à jour.
J’utilise de la pierre d’alun pour mes aisselles, normalement sans problème. Mais les déodorants à la pierre d’alun sont-ils nocifs ?
L’alun est un antitranspirant qui renferme des sels d’aluminium, mais en plus petite quantité que les antitranspirants classiques formulés à base d’aluminium chlorohydrate, par exemple.
Vous signalez que le savon Petit Marseillais contient des substances indésirables. Faut-il éviter d’acheter tous les produits de la gamme ou uniquement celui-là ?
Une référence ne parle que pour elle-même : on ne peut rien en conclure sur les autres produits de la marque. Un conseil : utilisez notre liste d’ingrédients indésirables pour examiner les étiquettes des autres produits.
Dans les produits de votre liste, on trouve des références vendues en grande surface et en pharmacie. J’utilise des produits Ricaud, ai-je une chance de les trouver dans la liste ? Vos enquêteurs vont-ils partout ?
Nous n’avons pas cherché à être représentatifs des marques, mais avons essayé de décrypter les étiquettes d’un maximum de produits de toutes sortes de marques grand public vendues en grande surface ou en parapharmacie. Ce sont aussi des marques que nous ont signalées nos lecteurs ; suite à notre premier dossier, en 2016. Les gammes plus luxueuses sont moins représentées, car elles concernent moins de consommateurs, de même que les marques plus confidentielles. Si vous voulez savoir si les produits que vous utilisez contiennent des ingrédients indésirables, vous pouvez vous reporter à notre liste de ces ingrédients avec les fiches qui les accompagnent et précisent le niveau de risque.
Vous pouvez consulter notre carte repère à imprimer.
Qu’en est-il de la fameuse crème Nivea que j’utilise abondamment tous les jours ? Quel danger nous guette si on l’a appliquée pendant des années ?
Nous ne pouvons pas vous répondre spécifiquement sur un produit ou une marque.
Nous vous conseillons de commencer par regarder si votre produit est présent dans notre base de données de plusieurs centaines de références. S’il n’y figure pas, regardez en détail quels ingrédients il renferme.
Quels produits de base faut-il conserver ? Que vaut Nivea, que je n’ai pas trouvé dans votre liste ?
Vous pouvez consommer tout type de produit cosmétique. Ce qu’il faut, c’est bien choisir les produits, et c’est pour cela que nous avons offert ces outils aux consommateurs. Si vous devez faire preuve de sobriété, il y a effectivement des produits dont on peut difficilement se passer : dentifrice, savon, shampooing…
Concernant Nivea, notre liste ne permet pas de tirer de conclusions sur les produits qui n’y figurent pas : soit ils ne contiennent pas d’ingrédients indésirables, soit ils en contiennent mais nous ont échappé. C’est pour cette raison, pour vous donner la possibilité d’acheter en toute indépendance, que nous mettons à votre disposition la liste des ingrédients indésirables.
Clarins est une marque assez vendue, elle est à la croisée des cosmétiques de grande marque onéreux et de ceux qui sont plus accessibles, or il semble que votre enquête n’en ait pas fait un sujet d’étude. C’est d’autant plus dommage que les consommatrices n’ont pas la possibilité de se faire une opinion au sujet de leur éventuelle nocivité, car leur composition n’est pas indiquée sur les contenants.
Clarins, comme tous les fabricants, est obligé d’indiquer la composition de ses produits sur les contenants. Elle peut être imprimée directement sur le flacon ou le pot, ou sur le carton qui l’entoure. Vérifiez bien ! Vous pourrez alors comparer les listes avec notre liste d’ingrédients indésirables. Et nous signaler, le cas échéant, des produits que nous pourrons y ajouter.
Deux de mes fils ont une peau atopique, aussi ont-ils été enduits de Dexeryl tous les jours après leur douche, de 18 mois à 5 ans environ. Cette crème, conseillée par le dermatologue, contient des perturbateurs endocriniens. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur leur santé ? Et sur moi-même (femme de 45 ans), qui utilise bi-quotidiennement une crème labiale contenant aussi des perturbateurs endocriniens ?
Il est impossible de prévoir exactement les conséquences de l’utilisation de ce produit, car la science en est à ses balbutiements concernant les perturbateurs endocriniens. Donc ne vous inquiétez pas trop pour cette utilisation passée. En revanche, en ce qui vous concerne, il pourrait être pertinent de changer de crème labiale, même si vous n’êtes a priori pas dans une des tranches d’âge les plus à risque.
La crème hydratante Dexeryl est prescrite par l’institut Curie pour accompagner la radiothérapie du sein. Est-elle pourtant nocive ?
Cette crème est très prescrite, elle est sans doute efficace, le problème est qu’on n’en connaît pas les éventuelles conséquences à long terme. Il serait souhaitable que les praticiens prescrivent un produit aussi efficace et dépourvu de perturbateurs endocriniens, surtout pour traiter des femmes ayant eu un cancer hormonodépendant. Le laboratoire se retranche derrière son autorisation de mise sur le marché et le fait que le rapport bénéfice/risque ait été jugé favorable, mais il serait vraiment souhaitable qu’il trouve un substitut au propylparaben !
Quelle marque de crème solaire faut-il appliquer à un enfant de 4 ans pour éviter tous ces produits perturbants ?
Regardez nos fiches ingrédients pour écarter les substances les plus problématiques pour les jeunes enfants. Les perturbateurs endocriniens et la MIT (methylisothiazolinone) sont les plus préoccupants.
Mais rassurez-vous, notre dernier test de crèmes solaires pour les enfants (juillet-août 2016) n’a pas révélé la présence de molécules indésirables dans les produits. Nous avions même noté un progrès par rapport aux formules pour les adultes testées précédemment. Ces dernières renfermaient des allergènes (les 26 qui proviennent des parfums), ce qui n’était pas le cas des crèmes pour enfants.
Quelle crème solaire privilégier ? Y a-t-il une alternative plus naturelle ? Je fais beaucoup de cosmétiques maison avec peu d’ingrédients pour éviter les perturbateurs endocriniens, mais c’est le seul produit que je trouve difficile à remplacer.
Et c’est normal ! Une crème solaire, c’est un produit très technique. Voyez le résultat désastreux de certaines crèmes solaires bio de notre dernier test. Nous vous conseillons de privilégier le produit déjà fait, car la protection UV assurée par la crème compte bien plus que la naturalité de la formule.
Les produits vendus en pharmacie ont-ils des effets nuisibles ? Si oui, pourquoi ne sont-ils pas retirés de la vente ?
On trouve en pharmacie les mêmes types de produit qu’en grande surface, car c’est avant tout un positionnement marketing. Ils ne sont pas retirés du marché parce qu’ils sont conformes à la réglementation des produits cosmétiques.
Je ne trouve pas de produits Mustela dans votre liste, cela signifie-t-il qu’ils ne présentent pas de problème particulier ?
Nous avons remarqué que Mustela, à l’issue de notre dossier de l’an dernier, avait modifié sur son site sa liste d’ingrédients non utilisés dans ses produits. Dans cette liste, il y a désormais tous nos ingrédients indésirables à l’exception du cyclopentasiloxane. Donc, a priori, ces produits méritent votre attention. Vérifiez tout de même à l’aide de notre carte repère que le produit que vous souhaitez acheter est sûr.
La pâte gingivale Arthrodont Enoxolone 1 % aurait pour ingrédients indésirables du sodium lauryl sulfate et du propylparaben, mais je n’ai pas trouvé le propylparaben sur l’étiquette. D’après mon médecin, mon dentiste et mon pharmacien, que j’ai interrogés, c’est un dentifrice pas plus dangereux que de très nombreux autres produits… Qui croire ?
Comme indiqué dans nos fiches, dans les produits ayant le statut de médicament, le propylparaben peut être indiqué sous le nom « parahydroxybenzoate de propyle ». Le propylparaben est considéré comme un perturbateur endocrinien et les experts européens estiment que les données sont insuffisantes pour conclure à un usage sûr dans les produits. Les professionnels de santé ne sont pas toujours au fait des dernières connaissances en toxicologie.
On parle des cosmétiques et des produits d’hygiène, mais qu’en est-il des lingettes pour les enfants ?
Le mieux est d’utiliser de l’eau et du savon (choisissez une marque qui ne contient pas d’ingrédients de notre liste) et d’éviter lingettes, produits spécial change, etc.
Les dentifrices font-ils partie de votre dossier ? Quels sont les maquillages et les déodorants à éviter ?
Reportez-vous à notre liste de produits : de nombreux dentifrices y figurent, ainsi que des déodorants. Les produits de maquillage sont moins bien représentés, à l’exception des vernis à ongles, mais ils auront tout à fait leur place dans notre liste à l’avenir. En attendant, pour choisir ceux exempts de substances indésirables, reportez-vous à notre carte repère.
Si je vous donne le nom d’un produit, pouvez-vous me dire s’il est toxique ?
Commencez par regarder s’il figure dans la base de données. Sinon, s’il renferme des ingrédients indésirables, vous devez utiliser notre formulaire de signalement.
Le cas particulier des produits cosmétiques bio
Peut-on éviter les ingrédients indésirables en utilisant des cosmétiques bio ?
Dans les cahiers des charges des cosmétiques bio, les perturbateurs endocriniens de notre liste sont effectivement exclus, pas directement mais parce que, globalement, les ingrédients issus de la pétrochimie sont interdits. Cela constitue déjà une garantie et, dans les faits, la majeure partie des substances indésirables que « Que Choisir » pointe du doigt ne se retrouvent pas dans les produits bio. Parmi notre liste d’ingrédients indésirables, mis à part les 26 allergènes à déclaration obligatoire, seuls le sodium lauryl sulfate et l’ammonium lauryl sulfate sont autorisés en bio.
Ils sont susceptibles de provoquer des irritations mais ne sont pas les plus « méchants ». En revanche, les produits bio qui utilisent beaucoup d’huiles essentielles peuvent être pourvoyeurs d’allergènes. Et là, attention, surtout chez les enfants !
J’utilise des produits cosmétiques bio. Y a-t-il des marques bio qui, le succès aidant, auraient « dévié » (si je puis dire ainsi) de leur mission initiale en introduisant des composants toxiques ?
Les produits bio certifiés sont contrôlés régulièrement par des organismes certificateurs (Écocert, BDIH, etc.). Le respect du cahier des charges est alors vérifié. C’est un gage de sérieux. Assurez-vous de la présence d’un label attestant de ce contrôle.
Que pensez-vous des produits bio allemands ?
Nous allons parler des produits bio en général. Les produits (souvent allemands) certifiés BDIH et ceux (de toutes origines) certifiés Écocert obéiront désormais au même cahier des charges. Certains produits allemands sont certifiés Natrue. Le cahier des charges est très complexe et dépend des produits : difficile de donner un avis général. Nous vous invitons à consulter notre enquête sur les produits cosmétiques bio (contenu réservé aux abonnés).
Les produits bio testés sur peau sensible peuvent-ils être allergènes ?
La mention « testé sur peau sensible » n’est pas encadrée, ne vous y fiez pas. Les allergènes sont présents dans les produits bio de façon relativement fréquente, car les huiles essentielles en contiennent souvent.
J’utilise des produits que l’on dit « bio » (par exemple Cattier) mais ils contiennent parfois des produits qui sont classés allergènes par vous (citral, citronellol, limonène). Pourtant, ils portent un logo Écocert, AB ou autre…
Précision : ce n’est pas nous qui classons ces substances allergènes, c’est la réglementation qui oblige à étiqueter 26 allergènes faisant partie de ceux qui provoquent le plus de réactions. Or, ils se trouvent à l’état naturel dans de nombreuses plantes, raison pour laquelle les produits bio ne peuvent les exclure.
Les allergènes bio provoquent-ils autant d’allergies que les chimiques ? Le Dr Hauschka affirme sur son site que les allergènes bio ne posent pas problème…
C’est une allégation sans fondement. Un allergène naturel reste un allergène. Comme on peut le constater dans le domaine alimentaire, de nombreux produits naturels, bio ou pas, sont allergènes : si vous êtes allergique à l’œuf, vous le serez aux œufs bio !
Les produits Nuxe censés être bio font des crèmes pour le visage contenant du phénoxyéthanol, est-ce un produit acceptable pour cette marque ?
Attention : Nuxe a deux gammes, l’une bio et l’autre pas. Elles sont clairement identifiées sur les emballages, donc si vous ne voyez pas le mot « bio » et le label correspondant, c’est un produit Nuxe conventionnel. Concernant le phénoxyéthanol, l’Agence nationale de sécurité des produits de santé estime que, en tenant compte des concentrations autorisées dans les produits destinés aux adultes (1 %), cet ingrédient ne pose pas de problème pour ces derniers.
La réglementation
Il paraît que la loi stipule que l’on doit indiquer tous les ingrédients qui entrent dans la fabrication d’un produit, sauf en dessous d’un certain pourcentage. Ce qui fait que l’on peut y mettre n’importe quoi à partir du moment où on ne retrouve que des « traces ». Est-ce vrai ?
Non, ce n’est pas le cas. Tous les ingrédients intentionnellement introduits doivent être étiquetés. Ils sont indiqués par ordre d’importance sauf ceux présents à moins de 1 %, qui peuvent être listés dans le désordre.
Serait-il possible que les noms des composants soient des termes plus compréhensibles et mémorisables par tous ? Car même si l’on a une liste des indésirables ou dangereux, lorsqu’on fait ses achats, il est difficile de s’en rappeler…
La réglementation est internationale, du fait de la circulation des produits. Les fabricants sont obligés d’adopter la même nomenclature qui mêle noms anglais et latins. Certains traduisent les noms des composés connus par ailleurs (par exemple : « aqua » = eau ; « castor oil » = huile de ricin ; « helianthus annuus » = tournesol).
Mais pour la plupart des ingrédients, notamment ceux issus de la pétrochimie, il semble difficile de trouver des noms plus compréhensibles et signifiants.
Pour ne pas avoir à en apprendre la liste par cœur, vous pouvez imprimer celle que nous mettons à disposition.
Serait-il possible que les étiquettes soient plus lisibles (les caractères sont trop petits) ?
Malheureusement, même si la réglementation précise que les caractères doivent être « facilement lisibles et visibles », ce n’est pas toujours le cas. Nous déplorons comme vous que les fabricants préfèrent parfois consacrer de l’espace aux allégations plus ou moins fondées qu’à cette information de base.
Si tant de spécialistes utilisent tant de produits indésirables, voire dangereux pour la santé des êtres humains, comment se fait-il que les pouvoirs publics français et européens ne fassent rien ?
Entre le moment où les experts émettent des recommandations de retrait ou de limitation d’un composé et la mise en œuvre concrète de ces recommandations sur le terrain, il peut se passer de nombreuses années, d’une part du fait de la lourdeur inhérente au processus réglementaire, mais aussi, bien sûr, du fait du lobbying des professionnels de l’industrie cosmétique.
Par exemple, il faudra attendre l’année 2021 pour que soit concrètement mise en œuvre la recommandation émise en 2012 par les experts de retirer trois allergènes présents dans de nombreux parfums, soit 9 longues années pendant lesquelles les consommateurs continueront d’y être exposés !
Peut-être le législateur devrait-il travailler plus rigoureusement et évaluer plus précisément les effets positifs et négatifs de ces matières premières sur le produit fini commercialisé, car certains ingrédients pourraient vraisemblablement être néfastes même à petites doses à terme sur quelques populations ? Qu’en est-il du principe de précaution pour bannir l’utilisation de ces ingrédients ?
C’est tout à fait exact, par exemple pour les allergènes qui peuvent occasionner des réactions immédiates et parfois violentes même à faible dose. La réglementation, si elle n’a pas été jusqu’à interdire tous les allergènes majeurs, oblige au moins à les indiquer dans les listes d’ingrédients.
Les réactions à très faibles doses concernent également les perturbateurs endocriniens, dont les impacts peuvent n’apparaître que longtemps après l’exposition. Des débats acharnés ont actuellement lieu au niveau européen pour tenter de donner une définition des perturbateurs endocriniens. Les décisions qui seront prises seront cruciales : en effet, selon la définition qui sera adoptée, la réglementation sera laxiste ou contraire protectrice pour les consommateurs.
Après avoir pris connaissance de différents articles de la revue « Que Choisir », je suis surpris que des laboratoires dermatologiques tels La Roche-Posay ou Avène proposent des produits (solaires et crème pour le visage) contenant des substances toxiques, alors qu’ils se positionnent sur le segment des peaux sensibles ! D’un point de vue légal, quels sont les leviers pour faire cesser ces aberrations ?
Le retentissement médiatique de nos actions permet bien sûr d’alerter les consommateurs, mais aussi de mettre la pression sur les fabricants. Nous avons ainsi noté des évolutions sur une vingtaine de produits qui ont réussi à se débarrasser de ces composants indésirables.
Par ailleurs, nos actions ont également un impact sur les pouvoirs publics français et européens, qui sont ainsi incités à résister au lobbying des professionnels et à renforcer la réglementation.
C’est sur la base du principe de précaution que sont émises les recommandations d’experts demandant le retrait des perturbateurs endocriniens compte tenu de la complexité à démontrer l’impact sur le long terme de ces molécules. La nocivité de certaines autres molécules irritantes ou allergisantes est amplement démontrée.
Quelle solution avons-nous, à part le boycott, pour faire interdire les produits (cosmétiques, alimentaires, phytosanitaire, etc.) susceptibles de tuer sinon rendre malades les consommateurs ? N’est-ce pas le devoir de l’État de protéger les citoyens ?
Rappelons tout d’abord que l’appel au boycott est interdit en France. En revanche, comme nous l’avons déjà indiqué, les achats des consommateurs en faveur des produits vierges de substances indésirables constituent un moyen de faire pression sur les fabricants pour qu’ils abandonnent l’usage de ces ingrédients indésirables sans attendre une évolution de la réglementation.
Serait-il envisageable d’utiliser, comme pour la nourriture, des pictogrammes rouge, orange ou vert pour indiquer la présence de substances toxiques ou allergènes ?
Du point de la réglementation européenne, malheureusement, aucune évolution dans le sens d’une meilleure lisibilité ou compréhension des étiquettes n’est à prévoir avant longtemps. C’est pour cela que nous avons développé ces outils (la carte repère pour faire vos courses et la base de données) pour vous aider à identifier les produits concernés.
J’ai acheté une eau de toilette, mais il n’y a pas moyen d’en connaître la composition. Est-ce normal ?
Contrairement aux autres cosmétiques, les emballages de parfums ne mentionnent pas obligatoirement la liste de leurs ingrédients, nous le déplorons. Nous ne pouvons vous renseigner car nous n’avons pas plus que vous cette information. Cela dit, il y a très fréquemment des allergènes dans les parfums.
Il est extrêmement difficile voire impossible de trouver des produits d’usage courant (shampoing, dentifrice…) sans ingrédients indésirables. Les associations telles que la vôtre ne peuvent-elles pas conclure avec certaines entreprises un cahier des charges contraignant dans leur intérêt et dans celui des consommateurs ?
Nous devons conserver notre indépendance vis-à-vis des fabricants, c’est pourquoi nous excluons tout partenariat avec des professionnels. En revanche, la liste des composés indésirables que nous avons déterminée est publique, elle est d’ailleurs basée sur des recommandations d’organismes experts qui sont bien connues des fabricants et de leurs syndicats professionnels.
Comment sait-on qu’une substance est perturbatrice du système hormonal ? Existe-t-il une liste officielle sûre ?
Malheureusement, il n’existe toujours pas de liste officielle. Les perturbateurs endocriniens présents dans notre liste y ont été intégrés après analyse de la littérature scientifique.
Est-ce qu’une action de groupe est envisageable contre ces professionnels qui nous empoisonnent ?
Une « class-action » (en français une « action de groupe ») n’est possible que dans les cas où des produits seraient non conformes à la réglementation.
J’ai lu que la Commission européenne renonce pour la troisième fois à soumettre au vote son projet de réglementation de ces produits chimiques. Est-il si compliqué que cela de définir ce qui doit être interdit ?
On ne peut que regretter l’incapacité de la Commission européenne à donner une définition satisfaisante des perturbateurs endocriniens. À ce jour, le projet de la Commission européenne demande un niveau de preuve tellement élevé qu’en pratique, aucune substance ne serait reconnue comme étant un perturbateur endocrinien. Pire, le projet prévoit des exemptions inadmissibles pour de nombreux pesticides !
À quoi bon faire des constats tous les jours dans la mesure où les gens responsables de l’aboutissement qu’on leur soumet ne les traitent pas ? Le danger, ce n’est pas les produits nocifs, c’est la façon délictueuse qu’ont certains de laisser faire. Essayez donc de déposer une plainte pour un produit qui vous a occasionné une allergie !
Le dépôt d’une plainte ne serait possible que dans le cas où un fabricant utiliserait un composé interdit. Or la très grande majorité des composés indésirables sont malheureusement autorisés, du fait de lenteurs réglementaires que nous déplorons.
Divers
Qu’y a-t-il dans certains parfums pour qu’ils me rendent malade : éternuements, larmoiement, gorge irritée, violents maux de tête, vertiges, etc. ?
Impossible à dire : cela peut être dû à diverses substances allergisantes présentes dans les parfums notamment parce que de nombreuses plantes en renferment.
Conseillez-vous d’arrêter d’utiliser et d’interdire toutes les pilules qui sont utilisées depuis de nombreuses années et peuvent être à l’origine de l’augmentation des troubles et des cancers ?
Les pilules contraceptives sont en effet le perturbateur endocrinien par excellence, elles sont mêmes faites pour ça. Par ailleurs, les pilules combinées ont été classées « cancérogène certain » par le Centre international de recherche sur le cancer. Une alternative trop peu prescrite (c’est une particularité française) est le dispositif intra-utérin (stérilet), qui allie efficacité, absence de risque d'oubli et coût raisonnable.
Les chimistes émettent des seuils subjectifs basés sur des connaissances scientifiques qui évoluent sans cesse et que le consommateur lambda n’est en principe pas en mesure de pouvoir contrôler sur sa personne… Comment prenez-vous en compte ces évolutions ?
C’est tout l’objet du travail de « Que Choisir », qui a « épluché » et réactualisé les recommandations des différents organismes experts aux niveaux français, européen et international.
Ces ingrédients indésirables assimilés dans l’organisme pendant des années peuvent-ils être soupçonnés de favoriser des maladies chroniques ? À 60 ans, je suis porteur d’un lymphœdème primaire (la cause n’est pas connue) des membres inférieurs depuis 2003.
La plupart des maladies étant multifactorielles (génétique + causes environnementales nombreuses : mode de vie, alimentation, qualité de l’air, etc.), on peut rarement attribuer une maladie à un facteur précis.
À quel niveau réel les produits cosmétiques sont-ils dangereux ? Quand le risque devient-il présent au niveau de la fréquence de consommation ? Existe-t-il vraiment des cosmétiques inoffensifs ? Le fait d’utiliser les cosmétiques du commerce me met-il en danger ?
La science n’est actuellement pas capable de répondre à ce genre de question. À côté des risques désormais bien connus comme le tabac, l’alcool en excès, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, etc. il y a des risques dont on commence seulement à cerner les contours. On ne peut vraiment pas déterminer le niveau de risque : il est peut-être élevé, peut-être limité, et puis tout dépend des ingrédients : ils ne sont pas tous aussi « méchants », reportez-vous à nos fiches.
Choisir des cosmétiques exempts de composés indésirables (il en existe !) et être plus « sobre » en matière de consommation de cosmétiques pendant les périodes clés (grossesse, petite enfance, adolescence) sont des précautions pertinentes.
Est-il envisagé de créer une application smartphone pour les produits cosmétiques selon le même format que « Open Fact Foods » pour l’alimentaire ? En Allemagne, l’application Toxfox permet de scanner les produits d’hygiène pour éliminer ceux qui sont toxiques. Ne serait-il pas utile de l’adapter en France ?
Nous travaillons à une application. C’est long à développer et nous avons besoin de temps pour proposer au consommateur un outil fiable.
Tous les jours, on apprend que des substances toxiques ou cancérigènes sont présentes dans les produits cosmétiques, mais ces produits ne sont jamais retirés du marché ! Toujours pour des raisons d’argent vis-à-vis des laboratoires qui les produisent… Ces derniers affirment que si ces substances existent bien dans leurs produits, le pourcentage est dans la norme autorisée. C’est bien de nous alerter, mais quand pourrons-nous aller plus loin dans la démarche ?
Par leur acte d’achat, en choisissant un produit indemne de ces substances indésirables, plutôt qu’en achetant à l’aveuglette, les consommateurs envoient un signal aux fabricants en les encourageant à enlever ces substances.
Fabienne Maleysson
Gaëlle Landry
Rédactrice technique
Olivier Andrault
Lire aussi