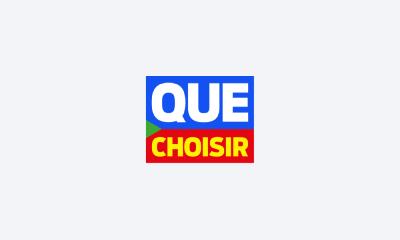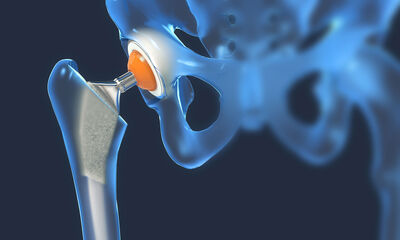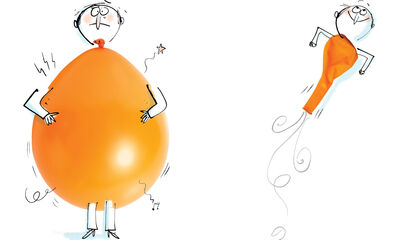par Emmanuelle Billon-Bernheim
DiverticuliteMoins de chirurgie pour "l’appendicite à gauche"
La diverticulite provoque des douleurs violentes du côté gauche du ventre. On a longtemps considéré qu’après plusieurs crises, il fallait opérer. Des recommandations récentes remettent en cause l’intérêt d’un acte chirurgical et définissent de nouvelles règles de prise en charge. Un article à lire pour ne pas « passer sur le billard » inutilement.
D’intenses douleurs dans l’aine gauche (fosse iliaque) associées à de la fièvre et à des troubles du transit sont souvent les signes d’une diverticulite aiguë. Cette inflammation ou infection au niveau d’un diverticule (excroissance le long de la paroi externe du côlon) est douloureuse et provoque de la fièvre. Les symptômes ressemblent à ceux d’une appendicite mais, au lieu d’être du côté droit, ils sont du côté gauche !
Très fréquente, cette maladie du côlon augmente avec l’âge. De nouvelles publications sur l’évolution naturelle de cette pathologie sont venues bouleverser les croyances : non, les crises qui se succèdent ne deviennent pas forcément de plus en plus graves. En fait, ce serait même plutôt l’inverse. Du coup, les dernières recommandations de bonne pratique tendent vers une restriction des indications du traitement chirurgical en prévention et vers une « désescalade » thérapeutique avec un recours moins fréquent à l’antibiothérapie et à l’hospitalisation. La Haute Autorité de santé (HAS) a publié en 2017 de nouvelles recommandations pour la prise en charge de cette maladie (1).
De quoi parle-t-on ?
- Un diverticule est une excroissance qui se développe le long de la paroi externe du côlon. La moitié de la population âgée de plus de 50 ans et 75 % de la population âgée de plus de 79 ans en ont. Les diverticules sont le plus souvent découverts fortuitement lors d’une coloscopie ou d’un scanner.
- La diverticulose du côlon correspond à la présence de diverticules. Cette anomalie anatomique passe inaperçue et ne provoque aucune douleur. Elle ne nécessite aucun traitement. Environ 10 à 25 % des patients qui en sont atteints auront une diverticulite.
- La diverticulite aiguë du côlon correspond à une inflammation ou une infection au niveau d’un diverticule. Elle est douloureuse et provoque de la fièvre.
Bon à savoir. Comme la majorité des diverticules siègent dans le côlon gauche, plus précisément dans le côlon sigmoïde, le terme de sigmoïdite diverticulaire est aussi employé pour désigner une diverticulite.
Vous subissez une crise de diverticulite aiguë
Quand les douleurs surviennent, la confirmation du diagnostic ainsi que l’évaluation des complications possibles reposent, si besoin, sur la réalisation d’un scanner abdomino-pelvien et d’un bilan sanguin. En revanche, la pratique d’une coloscopie pendant une phase de crise est contre-indiquée. Cet examen pourra être réalisé à distance de l’épisode aigu avant une éventuelle intervention ou en cas de doute diagnostique.
Si vous êtes par ailleurs en bonne santé
Il faut prendre des antidouleurs comme du paracétamol et consulter votre médecin qui vous prescrira un bilan (prise de sang et scanner si nécessaire). Le traitement ne nécessite pas obligatoirement des antibiotiques ni une hospitalisation. Il a été montré que, dans la grande majorité des cas, le traitement antibiotique ne diminuait pas le risque de complications, n’avait pas d’impact sur l’évolution de la maladie, notamment en termes de récidives, et n’accélérait pas le temps de récupération.
Il est inutile de faire régulièrement des prises de sang en cas d’évolution favorable ni de réaliser un scanner de contrôle. Et mangez ce qui vous plaît : aucune donnée scientifique ne montre qu’il faut respecter une restriction alimentaire lors de l’épisode aigu.
En cas de maladie, de traitements en cours ou de fièvre
Si vous souffrez d’une autre maladie (diabète, insuffisance rénale, immunodéficience, etc.), si vous prenez certains traitements (anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, immunomodulateurs, corticoïdes, etc.), si vous avez une forte fièvre ou, au contraire, une température très basse, vous êtes à risque de complications. Il faut consulter rapidement votre médecin. Si vous prenez des AINS, arrêtez-les. Attention, l’arrêt des corticoïdes ne doit pas se faire brusquement et sans avis médical.
Une antibiothérapie d’environ sept jours associant deux antibiotiques est souvent nécessaire. Par contre, inutile de vous astreindre à un régime alimentaire particulier comme cela était recommandé auparavant : mangez ce que vous voulez si vous le tolérez.
Vous avez une diverticulite compliquée
Dans de rares cas, la crise évolue vers la formation d’un abcès qui peut se rompre, provoquer une péritonite (infection du péritoine) ou une fistule (formation anormale d’un canal). Elle peut aussi évoluer vers la constitution progressive d’une sténose, un épaississement de la paroi du côlon qui devient « rigide » et provoque une occlusion.
Que faire ?
Une hospitalisation est nécessaire. Une antibiothérapie par voie intraveineuse sera entreprise. Selon la complication, une intervention chirurgicale en urgence peut être décidée.
Vous avez eu une diverticulite et avez peur de revivre une crise douloureuse
Dans la littérature, le risque de récidive de la diverticulite après une première poussée concerne environ un tiers des patients avec un recul moyen de dix ans. Mais, contrairement à ce qui était dit auparavant, l’évolution naturelle de la maladie ne se fait pas forcément vers une aggravation à chaque épisode. Même si les crises se succèdent, elles ne sont pas obligatoirement de plus en plus sévères. Au contraire même, elles diminuent souvent d’intensité pour finir par disparaître au fil des années.
Que faire ?
Il n’y a pas grand-chose à faire, à part limiter l’utilisation des corticoïdes et des AINS. Ces médicaments favorisent la survenue de la diverticulite et sont associés à un surrisque de complications, infectieuses ou hémorragiques.
Les données publiées à ce jour ne permettent pas de recommander un traitement en prévention de la survenue ou de la récidive de la diverticulite. Même à forte dose, ni les probiotiques ni la rifaximine (un antibiotique) ni la mésalazine (Fivasa, Pentasa) prescrits auparavant, séparément ou associés, n’ont fait la preuve de leur efficacité.
De même, aucun régime alimentaire spécifique, en particulier l’enrichissement de l’alimentation en fibres, n’a été associé à une diminution de la survenue ou de la récidive de la diverticulite. Inutile donc de vous priver de la consommation de fruits à coque (noix, noisette, amande, pistache, cacahuète, etc.) de blé, de maïs ou pop-corn comme il était conseillé précédemment.
Vous avez fait plusieurs crises de diverticulite
Le vieil adage prônant d’opérer après deux épisodes de diverticulite est parti aux oubliettes. Les indications d’une intervention chirurgicale « à froid », après un épisode aigu, pour prévenir le risque de récidive (chirurgie prophylactique) fondent comme neige au soleil. Elles reposaient sur des données épidémiologiques de faible puissance et anciennes. Récemment, de très nombreuses publications sur des cohortes regroupant un grand nombre de patients non opérés montrent que les risques encourus sont faibles. Au contraire, elles indiquent qu’une intervention chirurgicale préventive expose à des risques chirurgicaux sans raison véritable.
Pour la Haute Autorité de santé, c’est très clair : « L’essor de la chirurgie colorectale laparoscopique [qui permet d’opérer sans ouvrir le ventre] a même favorisé l’attitude “agressive” chirurgicale de colectomie dite prophylactique [chirurgie du côlon dite de prévention] sans que celle-ci ne soit forcément justifiée. » Les plus récentes lignes directrices recommandent des décisions au cas par cas.
Que faire ?
Lors de la crise douloureuse, consultez votre médecin qui vous prescrira pour vous soulager des antidouleurs comme le paracétamol et, si besoin, des antibiotiques. Même en cas « d’attaques importantes » de diverticulite, une chirurgie afin de prévenir la récidive n’est plus justifiée.
Il est à noter que l’âge n’entre plus en ligne de compte : il n’y a pas d’indication supplémentaire à effectuer une chirurgie préventive chez les moins de 50 ans.
Les autres causes de douleur à gauche
Toutes les douleurs de la fosse iliaque (l’aine) gauche ne sont pas des diverticulites. Il faut aussi penser à une colite due à une maladie inflammatoire chronique de l’intestin comme la maladie de Crohn ou à un problème urinaire (pyélonéphrite) ou même, chez la femme, à un problème gynécologique (salpingite).
À retenir
En cas de diverticulite, une intervention chirurgicale est envisagée dorénavant seulement :
- si vous avez fait un épisode compliqué (abcès, fistule, perforation) ;
- si vous êtes à haut risque de complications ;
- si les symptômes persistent après une poussée ;
- si les récidives sont fréquentes et impactent la qualité de vie.
(1) « Prise en charge médicale et chirurgicale de la diverticulite colique, recommandation de bonne pratique », HAS, 11/17.
Emmanuelle Billon-Bernheim
Lire aussi